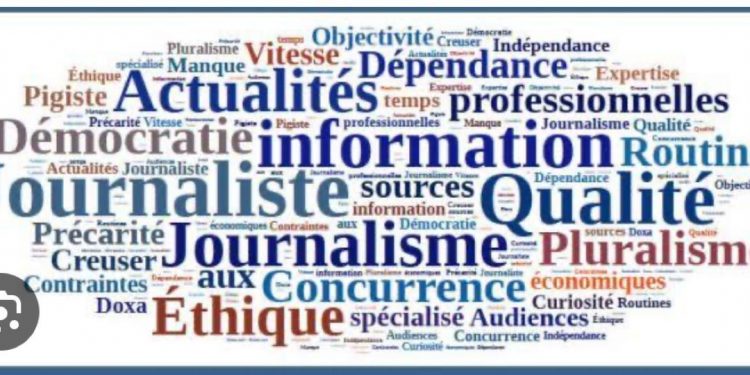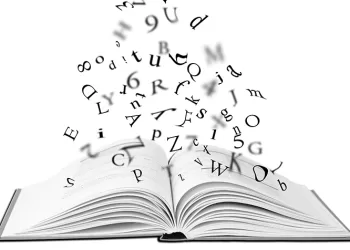Dr Oussama Al-Saïd, écrivain et chercheur en relations internationales et médias
Directeur éditorial du journal Al-AKhbar

Introduction :
Pendant des décennies, le discours sur les valeurs morales du journalisme (écrit, audiovisuel et numérique) a engendré un héritage occidental de valeurs que les grandes institutions aux Etats-Unis et en Europe cherchent à monopoliser et s’en targuent. Ces dernières cherchent souvent à présenter ces valeurs, telles que l’objectivité, l’impartialité et la probité comme un modèle pratique pour l’exercice de cette profession. Cela a poussé de nombreux journalistes et experts en la matière à considérer ces institutions journalistiques occidentales comme un point de référence pour l’évaluation de leurs homologues dans le monde entier.
Bien que ces considérations soient ancrées depuis des décennies, de nombreuses questions relatives au Moyen-Orient et, par-dessus tout, le conflit israélo-palestinien, ont toujours été une exception, pas seulement en raison de la nature controversée du conflit, mais en raison de la performance professionnelle de nombreuses institutions médiatiques occidentales qui négligent souvent les standards fixés et les valeurs prônées par les médias occidentaux. Ceux-ci mettent en place l’éthique de l’exercice du journalisme et définissent ses règles et normes comme étant un cadre de travail les rendant distincts des autres médias non occidentaux, alors que ces derniers sont souvent décrits comme « autoritaires » et stigmatisés par leur subordination aux autorités gouvernementales.

La plupart du temps, les médias occidentaux, ou du moins le courant dominant, n’ont pas été moins subordonnés aux positions de leurs régimes, ou au réseau d’intérêts et de lobbys d’Israël. Ce soutien aux lobbys israéliens a été reflété par la couverture médiatique occidentale de la récente guerre israélienne contre Gaza qui a éclaté à la suite de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » menée par le Hamas et des membres des factions de la résistance palestinienne le 7 octobre 2023.
Cette couverture a fourni une perspective supplémentaire pour l’analyse critique de la performance des médias occidentaux, en particulier avec l’existence des plateformes de médias sociaux qui imposent de nouvelles tendances dans la couverture du conflit. Ces plateformes sont de plus en plus utilisées par les masses. Ces dernières commencent à tourner le dos aux médias traditionnels largement critiqués même au sein de leurs communautés en raison de leurs biais systématiques dans la couverture du conflit israélo-palestinien.
Malgré de nombreuses réserves soulevées sur l’exactitude et la méthodologie des soi-disant médias occidentaux en tant que composante cohérente présentant un contenu commun pouvant être analysé pour en déduire des normes harmonisées régissant la nature de la structure intellectuelle et informationnelle de ces médias, il existe des traits communs sur lesquels ils s’appuient afin d’œuvrer dans le cadre de la culture occidentale et de cibler principalement le public occidental. Toutefois, les effets de ces médias dépassent les frontières géographiques des pays qui les créent ou qui les diffusent.
Il est vrai qu’il n’y a pas toujours de « médias occidentaux » unifiés et qu’il en existe une grande diversité en fonction du pays, de la culture et de la langue. Il y a également des différences dans leurs tendances politiques, culturelles et religieuses. Ceci étant, il existe une grande diversité dans le contenu et les moyens utilisés. De nombreux chercheurs reconnaissent cependant qu’il existe des modèles homogènes de traitement des questions liées à des conflits majeurs ou des événements affectant l’essence de la culture et de l’idéologie capitaliste, ainsi que l’entrelacement de leurs intérêts transnationaux.

Les médias et la gestion de la perception
Dans le domaine des médias, on s’accorde à dire que « la première victime de la guerre est la vérité ». Souvent, surtout lorsque l’on couvre des conflits hautement controversés tels que le conflit israélo-palestinien, avec ses dimensions historiques, politiques, idéologiques et parfois religieuses, le strict respect des normes morales professionnelles est remis en cause.
Comme pour les processus politiques, les guerres ont deux aspects : le premier est matériel qui se décide sur le terrain, et l’autre est moral, défini par les outils du « soft power » principalement les médias. Comme les dirigeants qui décident de faire la guerre trouvent des « prétextes moraux » pour justifier le meurtre de civils ou le massacre d’enfants, les médias qui s’engagent dans la « guerre morale » ne manquent jamais de créer des « prétextes moraux », pour justifier la manipulation de l’opinion publique, le mensonge et le terrorisme intellectuel.
Dans ce deuxième champ de bataille, l’une des plus grandes opérations de « gestion de la perception » se déroule. Il s’agit d’une guerre d’images, d’informations et d’émotions, la première bataille ne sera tranchée sans son soutien.
En fait, de nombreuses analyses du contenu de la couverture occidentale — historiquement — ont révélé de nombreux exemples de partialité qui, à force de leur continuité, sont devenus ce qu’on pourrait appeler des « biais systématiques ». Ces derniers contribuent clairement à la « gestion de la perception » non seulement des citoyens des pays qui manipulent ces médias occidentaux, mais aussi d’un public au-delà de leurs frontières géographiques.
Un grand nombre de recherches sur les médias ont mis l’accent sur la couverture du conflit israélo-palestinien par les médias américains et européens, et a démontré un grave défaut de la couverture médiatique au profit d’Israël.
Bon nombre de ces études considèrent que le déséquilibre réside dans l’omission du contexte historique des événements couverts. Il y a une différence importante dans la présentation des bilans des victimes des deux camps. Premièrement, les chiffres des victimes palestiniennes étaient « inexacts » et ne correspondaient pas au nombre de documents d’information. Et deuxièmement, ils ne sont ni définis ni décrits méticuleusement à l’opposé des victimes israéliennes dont des profils biens détaillés sont présentés en boucle à travers les divers médias.
L’absence de l’équilibre médiatique
La couverture médiatique occidentale de l’agression récente d’Israël contre la bande de Gaza à la suite de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » n’était pas différente de ces précédentes. Elle est peut-être encore plus biaisée et plus systématique compte tenu de la violence de l’attaque menée par le Hamas et les factions de résistance palestiniennes, de la chute d’un nombre sans précédent de victimes israéliennes et de la détention d’environ 240 prisonniers militaires et détenus civils, ce qui est sans précédent dans l’histoire des affrontements entre les deux parties. Ceci étant, les médias occidentaux se sont montrés plus biaisés que jamais.

Ces biais ne se limitent pas au contenu de la couverture des médias occidentaux mais s’étendent au nombre exagéré des correspondants et équipes envoyés pour couvrir le conflit. Plus de 2050 journalistes sont arrivés en Israël pour couvrir la guerre, selon le gouvernement israélien, la majorité d’entre eux (358 journalistes) des médias américains, les médias britanniques sont arrivés en deuxième position (281 journalistes) suivis par les médias français (221 journalistes), et même les médias en Ukraine, qui est en guerre depuis près de deux ans, ont envoyé des équipes de médias en Israël.
En revanche, les grands médias occidentaux semblaient être « presque absents » des événements à Gaza, car ils s’appuyaient principalement sur leurs correspondants en Israël, ou au mieux sur les journalistes présents en Cisjordanie, alors que cette couverture de terrain à Gaza était absente, sous prétexte, entre autres, des difficultés à faire accéder les équipes médiatiques.
Il y a un ciblage délibéré des journalistes et des équipes de médias sur le terrain, et selon un décompte indéfini, 71 journalistes ont été tués lors de la couverture des événements dans la bande de Gaza du 7 octobre au 30 novembre, 2023, ce qui révèle que la tendance d’Israël à cibler les journalistes n’est pas une coïncidence, mais, selon un rapport du CPJ, est devenue une « tendance mortelle ».

Les biais de la couverture médiatique occidentale
Le biais dans la couverture des nouvelles selon le manuel « Normes professionnelles dans la rédaction de nouvelles » est « L’auto-alignement ou le favoritisme, ou la vision unilatérale, une approche réformiste de l’information, qui n’est pas sans la motivation de la fausse représentation et de l’altération de l’information, des choix qui servent un point de vue particulier ». « Être biais » en temps de conflit peut parfois devenir un « acte politique » avec un rôle et une influence dans le cours des événements.
Selon ce manuel, près de 40 types d’actes marqués de partialité menés par les médias dans leur couverture du conflit sont détectés, en particulier lorsqu’il s’agit de questions de nature polarisante.
On peut citer une série de préjugés qui ont caractérisé la couverture médiatique occidentale des événements du 7 octobre 2023 et de l’agression israélienne sans précédent contre la bande de Gaza en particulier et les territoires palestiniens occupés en général, notamment :
• Partialité par manque de contexte
Dans ce type de partialité, le contenu médiatique ne fournit pas le contexte historique de l’événement médiatisé, ou présente ce contexte de manière incomplète ou déformée. Ce parti pris semble être évident dans les diverses couvertures occidentales du conflit dans les territoires palestiniens occupés, au fil des siècles. A titre d’exemple, ne jamais mentionner le fait qu’Israël est une autorité occupante, et négliger en même temps de reconnaître les forces et les factions palestiniennes comme des mouvements de résistance légitimes.
Cette distorsion délibérée conduit à deux formes de graves erreurs. Premièrement, la désignation des mouvements de résistance palestiniens comme « groupes terroristes », et donc, deuxième erreur fatale, considérer tout ce qu’Israël fait pour affronter leurs attaques comme un « droit de légitime défense ».
• Partialité par omission
Cette partialité peut se produire en omettant soit dans une histoire, soit à long terme, un ensemble de faits centraux ou les principales raisons pour lesquelles les événements évoluent dans un contexte spécifique.
Au cours de la couverture médiatique occidentale des précédents épisodes du conflit, les médias ont négligé de nombreux faits, et se sont en revanche concentrés sur d’autres facteurs pour construire une histoire au profit d’Israël.
L’un des faits les plus importants est la limitation du conflit à Israël et au Hamas, et l’omission préméditée de la chronologie du conflit qui remonte à des siècles avant même que le Hamas n’existe, ainsi que la participation de nombreuses autres factions palestiniennes à la résistance.
La couverture médiatique occidentale a également négligé le fait que l’attaque du 7 octobre est la conséquence de l’intransigeance d’Israël qui refuse toute solution politique à la cause palestinienne et qui recourt toujours à la force et aux solutions militaires.
• Partialité par sélection des sources
Cette méthode est utilisée à plusieurs niveaux, notamment en sélectionnant des sources dont le parcours professionnel ou idéologique est parfaitement connu et en les présentant comme des sources impartiales, ou en intensifiant l’apparition d’une équipe de sources et d’intervenants soutenant un point de vue particulier, tout en marginalisant les représentants de l’autre point de vue.
A titre d’exemple, la chaîne américaine CBS a supprimé une intervention d’un invité palestinien, justifiant l’affaire en disant que l’interview comprenait « des critiques de la part de l’invité sur la façon dont la chaîne avait présenté les actions d’Israël, et qu’elle était très hostile. » L’invité a rapporté que la chaîne avait décrit les attaques du « Hamas » les qualifiant de « barbares » et qu’elle « lui a demandé d’utiliser le même terme pour décrire ce que fait Israël. » Le site américain « Jewish Current » a souligné que « les commentateurs palestiniens ont été marginalisés par les grands réseaux d’information, » en plus de l’exclusion des voix dans les médias simplement en raison de leur origine arabe ou musulmane, ou parce qu’elles parlent des droits des Palestiniens.
• Partialité contre l’opinion publique
Bien que les formes précédentes et d’autres modèles de préjugés professionnels et politiques semblent attendus et habituels, d’autant plus qu’ils ont été utilisés à plusieurs reprises dans la couverture médiatique occidentale de la question palestinienne au fil des décennies, même s’ils ont gagné en intensité et en importance au cours de la couverture de l’agression contre Gaza après le 7 octobre 2023, ce schéma est différent, ce qui a attiré l’attention de nombreux chercheurs et observateurs.
De nombreux sondages qui ont été menés alors que la guerre contre Gaza entamait son deuxième mois ont révélé de sérieux changements dans la position populaire concernant la crise, y compris un sondage réalisé par Reuters – Ipsos, qui a indiqué un déclin du soutien populaire aux États-Unis à la guerre israélienne contre Gaza. Ledit sondage a révélé que la majorité du peuple américain voit la nécessité d’un cessez-le-feu de la part d’Israël contre le peuple palestinien d’autant plus que le conflit s’est transformé en crise humanitaire. C’est une position qui contredit la politique américaine et n’est pas non plus abordée dans la plupart des médias américains, en particulier par les médias les plus répandus et les plus influents.

Ces sondages ont mis en évidence une division parmi les Américains entre partisans, opposants et neutres, ce qui a conduit à une baisse significative de la popularité du président américain Joe Biden en raison de son soutien absolu à Israël dans sa guerre contre Gaza. S’ajoute à cela le sondage réalisé par Gallup, qui a montré – pour la première fois- la sympathie des démocrates pour les Palestiniens plus que pour les Israéliens.
En conjonction avec l’outil de « l’intimidation », Israël a utilisé l’arme de la « compassion », représentée par d’intenses campagnes publicitaires et en employant de grandes capacités matérielles et techniques pour faire face à la tendance croissante au soutien aux Palestiniens sur les plateformes de médias sociaux. « Libération » a révélé qu’« Israël a payé des millions de dollars pour promouvoir sa version sur la guerre.
Selon un rapport d’enquête de POLITICO, à la suite de l’attaque du 7 octobre, le gouvernement israélien a lancé une campagne massive sur les réseaux sociaux dans les principaux pays occidentaux pour obtenir le soutien à son offensive militaire contre le groupe du Hamas. Une partie de sa stratégie : diffuser des dizaines de publicités contenant des images dures et émotionnelles de violences meurtrières en Israël sur des plateformes comme X et YouTube.
Conclusion:
Toutes les données précédentes confirment que la structure intellectuelle, politique et médiatique occidentale en faveur d’Israël est toujours cohérente, malgré les transformations qu’elle connaît suite à l’entrée des plateformes de réseaux sociaux. Cela a provoqué un écart toujours plus grand entre les positions populaires adoptées par de larges segments de l’opinion publique (principalement les jeunes) dans de nombreux pays occidentaux et les positions officielles qui s’accrochent encore à un soutien illimité à Israël.
De plus, les changements tangibles dans la couverture médiatique occidentale de la crise à Gaza- notamment en raison de la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza- ne peuvent pas être considérés comme la preuve d’un changement fondamental dans la vision et la performance de ces médias.
Par conséquent, nous ne devrions pas nous laisser convaincre que la cause palestinienne est victorieuse à elle seule. Cette question nécessite un effort coordonné et un travail institutionnel pour soutenir le discours palestinien et arabe dans les médias occidentaux (traditionnels et nouveaux), d’autant plus que le côtéisraélien fait preuve d’habilité à employer ces outils et à mobiliser de grandes capacités matérielles et techniques pour y parvenir. Le contrôle et la victoire dans la « guerre des esprits » ne sont pas moins importants, voire ils sont plus importants que les outils traditionnels de guerre.