Situé à huit kilomètres au nord de Gizeh, la zone Abou Rawash est un site archéologique riche de toute une période pharaonique longue qui s’échelonne de la période prédynastique à la période copte. Elle se caractérise presque exclusivement par des structures funéraires et des lieux de culte appartenant aux périodes les plus récentes. La région comporte une nécropole de la 1ère dynastie, les ruines de la pyramide de Djédefrê et une nécropole de hauts responsables de la 4ème dynastie. Le site est surtout connu par la pyramide de Redjedef datant du milieu de la IVe dynastie, celle-là domine toute la région. L’occupation la plus ancienne renferme un groupe de cimetières datés de la fin du prédynastique et de la période protodynastique, que domine le cimetière d’élite M avec ses grands mastabas en briques crues installés sur un plateau dominant la vallée du Nil.
En plus, il existe dans la région aussi des galeries rupestres à Ouadi Qaren datées du IVe siècle, une enceinte pharaonique mal datée, un couvent copte du ve siècle, des tombes rupestres du Nouvel Empire, et les ruines d’un monument en brique crue nommé Pyramide n1 de Lepsius.

L’Ifao entreprit les premières véritables fouilles archéologiques de 1901 à 1902, conduites par l’initiative de Émile Chassinat, directeur de l’Institut français d’archéologie orientale IFAO. en dégageant la face orientale de la pyramide. La découverte de fragments de statues en quartzite, inscrits pour certains d’entre eux, permit d’attribuer le monument à Rêdjedef, fils de Khéops et troisième souverain de la IVe dynastie (vers 2580 av. J.-C.), selon archeonil.fr.
Les recherches reprirent sur la pyramide entre 1912 et 1913 sous la direction de P. Lacau. Celui-ci s’intéressa également aux environs du monument. Dès 1913, il confia à P. Montet la fouille d’un petit cimetière archaïque à l’ouest de la pyramide, dénommé M d’après l’initiale du nom de son premier fouilleur, Pierre Montet ; et en 1922, il octroya à F. Bisson de la Roque, la charge d’étudier la nécropole voisine de l’Ancien Empire.
Les travaux sur le cimetière M et les nécropoles thinites situées au pied de la colline furent poursuivis de 1957 à 1959 par une équipe du musée de Leyde dirigée par A. Klasens. Les fouilles ont repris dans les années 1990-2000 sur le complexe de Rêdjedef dans le cadre d’un projet conjoint Ifao/Université de Genève. Les études se sont ensuite portées au nord-est de la pyramide, sur le cimetière d’élite de la IVe dynastie, sous la conduite de M. Baud jusqu’en 2009. Depuis cette date, les investigations ont repris sur le cimetière protodynastique. Oubliés pendant plus d’un siècle, les grands tombeaux du cimetière M ont bénéficié récemment d’un nouveau programme archéologique mené par l’Institut français d’archéologie orientale du Caire en collaboration avec la Macquarie University de Sydney en Australie.
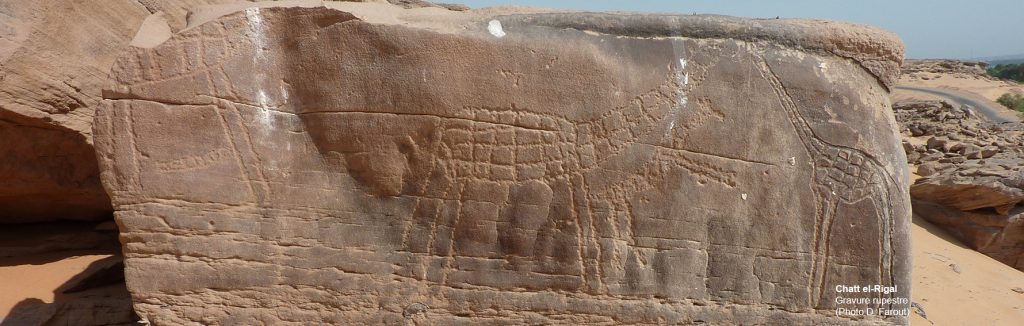
Selon le site de l’Ifao, les principaux objectifs du projet concernent l’étude des pratiques funéraires de l’époque protodynastique, de l’architecture des mastabas en briques crues de la Ire dynastie, du contexte social des individus enterrés sur le site et du développement chronologique du cimetière.
Au total 15 mastabas ont pu être entièrement refouillés et étudiés, ainsi que les tombes subsidiaires associées, certaines d’entre elles sont encore intactes. Des plans et relevés précis de chacun des monuments sont maintenant accessibles et seront publiés dans les monographies en cours de préparation.
La datation fine du site bénéficie d’une bonne série de datations 14C (cinq disponibles et une dizaine en cours au laboratoire de l’Ifao) provenant de sources diverses (briques crues, cercueils en bois, barques funéraires, plancher brûlé, etc.) qui constituera également un cadre de référence pour le règne de Den. L’examen anthropologique des squelettes trouvés in situ dans les tombes subsidiaires montre d’ores et déjà que les individus inhumés sont de sexe et d’âge très variés, et surtout qu’ils ne présentent aucune trace de violence, contredisant en cela toute idée de sacrifice humain. Un intérêt particulier a aussi été apporté au mode de fermeture des tombeaux et au mobilier associé qui tend à montrer que ces individus ne sont pas des morts d’accompagnement.
Malgré l’état de dégradation des monuments des observations intéressantes ont pu être faites sur leur architecture et aussi sur le mode de construction des mastabas. La destruction avancée des monuments a permis ainsi d’étudier les modes de creusement des chambres rupestres, les couches de nivellement et de préparation des monuments, ainsi que les dépôts de fondation situés sous les murs des monuments.





